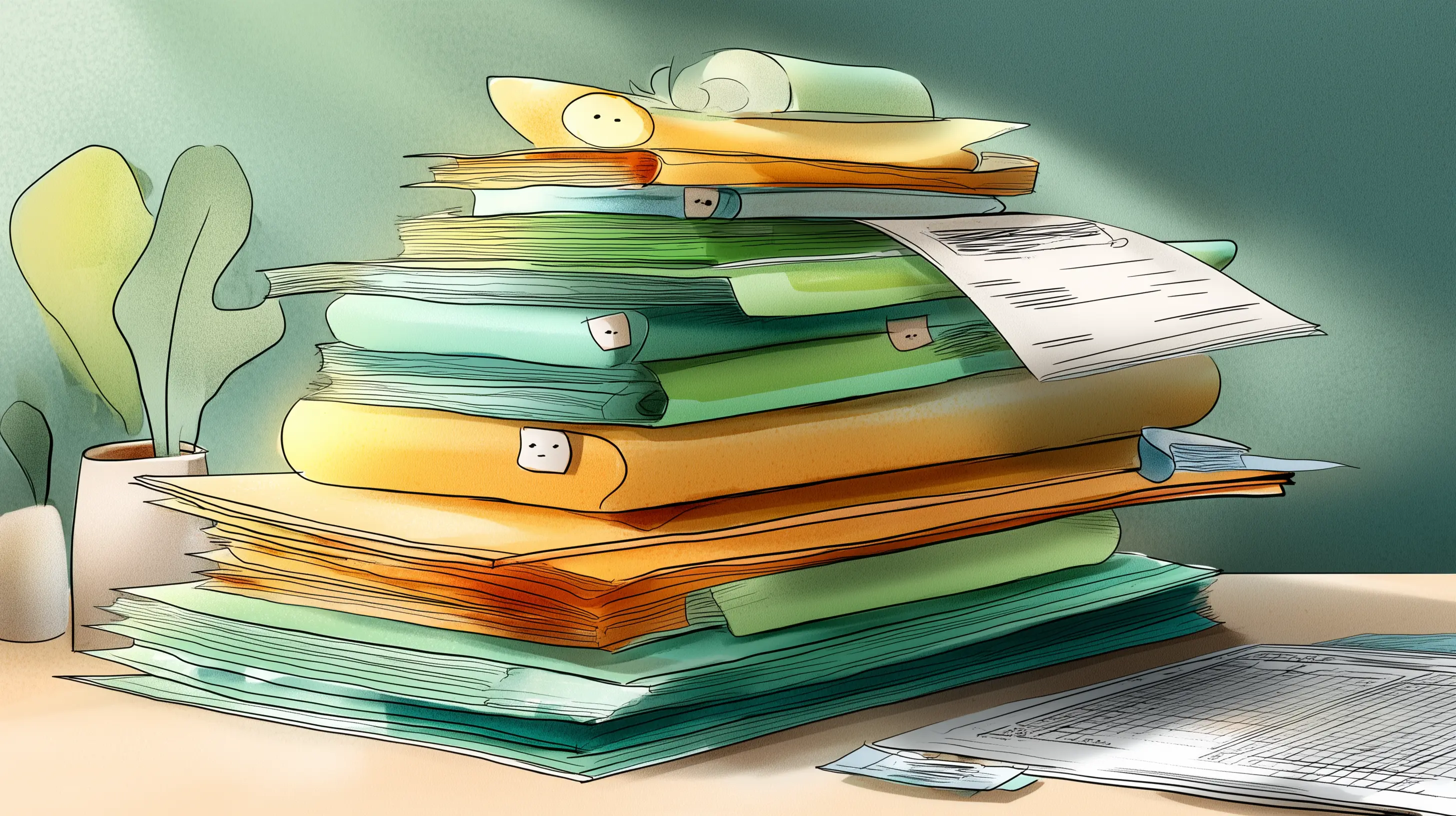18 Semaines de Congé Parental Total
Genève offre déjà des conditions supérieures au minimum fédéral avec des semaines supplémentaires.
- Congé maternité : 16 semaines (14 fédérales + 2 cantonales)
- Congé paternité : 2 semaines (fédérales)
- Total de 18 semaines pour le couple
- Financement cantonal pour les semaines supplémentaires